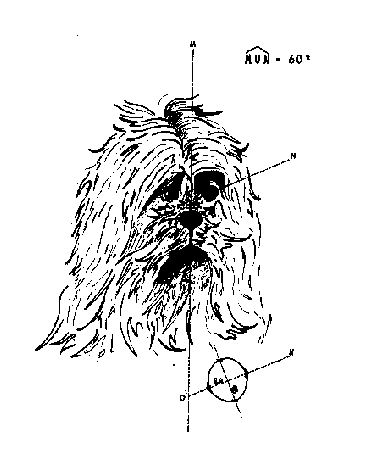
les articles
LE TERRIER DE LHASSA
Thèse du Docteur vétérinaire Guy Lescure Publiée en 1961
Introduction
La cynologie doit éclairer, renseigner, éduquer et instruire la cynophilie.
Que de races sont à l’état d’oscillations désordonnées, faute de standards fixés par des normes anatomiques, physiologiques et zootechniques rationnelles.
Cet aimable empirisme qui préside à l’élaboration de trop de standards autorise souvent la plus haute fantaisie en matière de « races de luxe ». Fantaisie excusable certes, car ce sont ces « chiens d’agrément » qui subissent en premier ordre la douce tyrannie de cet amour des bêtes : la cynophilie.
Le Terrier de Lhassa appartient à ces races de petits chiens thibétains considérées comme les plus vieilles du monde. Son arrivée en Europe est cependant très récente. Cette apparition tardive et le mystère sciemment entretenu qui entoure ces lointaines origines ont contribué à la livrer à la mode et au snobisme.
Plusieurs standards, des appellations variées lui ont été affectés.
Il mérite pourtant que l’on s’attache à en posséder une connaissance aussi exacte que possible, car, outre sa beauté aristocratique, sa place, à proximité de certaines souches zoologiques canines, son rôle incontestable dans la vie sociale de son pays et même dans la mythologie et la religion bouddhiste thibétaine contribuent à sa noblesse.
Nous avons, ici, essayé de reconstituer l’histoire du Terrier de Lhassa, de retracer sa vie dans son Thibet natal, puis de la suivre dans son périple asiatique jusqu’à son arrivée en Europe et là, au milieu de la confusion des variantes créées par le croisement avec certaines races des pays traversés, nous nous sommes attachés à retrouver le type initial et à fixer un standard scientifique, tel qu’il a été défini par le Congrès cynologique mondial de Monaco, en mars 1934.
Chapitre premier
LES CHIENS AU THIBET
La diversité des races canines existantes avait poussé certains auteurs à voir des souches différentes à l’origine de l’espèce « canis familiaris ».
Actuellement on reconnaît un ancêtre unique : le Tomarctus, apparu en Europe il y a 15 millions d’années environ ; certains de ses descendants auraient ensuite émigré en Asie et plus particulièrement au Thibet.
Il existe actuellement au Thibet plusieurs races de chiens indigènes parmi lesquelles :
- le molosse du Thibet
- l’épagneul du Thibet
- le Terrier du Thibet
- le Terrier de Lhassa
Le molosse du Thibet
Cet énorme dogue noir est indiscutablement le chien le plus répandu au Thibet où on l’appelle parfois Dokyi, c'est-à-dire « chien que l’on peut attacher ». Il surveille férocement l’entrée des villages, des campements nomades et surtout les habitations de riches lamas.
Madame Alexandra David Néel, dans un récit de son voyage vers Lhassa, relate souvent les rencontres peu sympathiques qu’elle fit avec ces terribles gardiens. Hérodote avait été impressionné par la férocité de ces molosses qui gardaient les mines d’or au Thibet occidental.
Le molosse thibétain est un chien de grand format, mesurant entre 0.75 et 0.85 m. au garrot et pouvant peser 100 kg.
Marco Polo, lors de son voyage au Thibet au XIVème siècle, le vit aussi grand qu’un âne ; sans doute exagérait-il, bien que les ânes thibétains soient particulièrement petits. Sa tête est très lourde, avec des oreilles petites et pendantes et un front garni de rides très profondes comme chez le Blood-Hound.
Fortement charpenté, à membres courts, il a une robe à poils long et durs entièrement noirs avec des marques de feu. D’aspect très vigoureux, il marche avec lenteur et majesté.
L’épagneul du Thibet
C’est un petit chien de la taille d’un fort épagneul papillon, il semble plutôt répandu dans la région de Sikkim comme chien d’agrément. Son poil est long et plat, de couleurs variées, noir et blanc, noir et feu, acajou et marron.
Terrier du Thibet – Terrier de Lhassa – Apso
Les chiens de petites races sont appelés au Thibet comme en Chine « chiens lions » car il ont tous une robe très fournie, particulièrement dans la région cervicale où les poils extrêmement longs forment une crinière. On peut distinguer, parmi ces petits chiens à longs poils, deux types qui diffèrent surtout par la taille. Un premier type mesurant entre 3à et 40 centimètres au garrot, plus fréquemment rencontré dans le Thibet occidental est connu en Europe sous le nom de griffon ou terrier thibétain.
L’autre type, plus petit, est plus recherché et élevé dans la région de Lhassa : il est nommé chien de Lhassa ou encore Apso. C’est le terrier de Lhassa européen
Chapitre deux
Le terrier de Lhassa au Thibet
Le terrier de Lhassa est élevé depuis fort longtemps par les riches familles et les lamas Thibétains avec un grand souci de conserver ses caractéristiques morphologiques. Sa petite taille, qui répond au goût des orientaux pour les miniatures, et la richesse originale de sa fourrure contribuent à sa noblesse.
Le terrier de Lhassa et la mythologie thibétaine
L’aspect léonin que donne sa fourrure abondante au petit chien de Lhassa a certainement frappé les Thibétains dont l’esprit religieux est très profond. Ils l’ont baptisé « chien lion » et l’élève avec soin, s’attachant à la pureté de la race afin de conserver cette ressemblance lointaine avec le lion mythologique.
En effet, le lion joue un grand rôle dans la mythologie lamaïste.
La déesse Lha-Mô, protectrice du grand Lama de Lhassa porte dans son oreille droite un lion dont Kubera, Dieu des richesses, lui a fait présent ; ce lion est gardien de la Loi. L’tcham Sring, Dieu de la Guerre, est assisté d’une divinité qui monte un lion.
N’oublions pas enfin que le drapeau thibétain comportait un lion brodé sur fond cramoisi.
Le terrier de Lhassa et la religion thibétaine.
Certains possesseurs Européens de terriers de Lhassa prétendent que cette race est sacrée au Thibet. Les « chiens lions », élevés avec des soins religieux dans les deux grandes lamaseries de Sera et Garden, aux environs de Lhassa, seraient les réincarnations de lamas n’ayant pu accéder au « Paradis oriental de la grande béatitude ».
Les chiens sacrés garderaient les trésors de Bouddha et spécialement dressés, participeraient à des cérémonies religieuses.
Nous avons vainement cherché, dans les études sur le bouddhisme thibétain, une allusion quelconque au caractère sacré des « chiens lions ». Selon Madame Alexandra David Néel, qui a consacré de nombreux ouvrages sur le Thibet, le lamaïsme admet que la continuité du « mental » est assurée par une succession de vies dans les six mondes : celui des hommes, des animaux, des génies, des titans, des Dieux et des habitants de l’Enfer.
Ces réincarnations possibles, en des mondes différents, correspondraient au purgatoire chrétien, mais un purgatoire avec des degrés divers avant d’atteindre l’état de béatitude totale, l’état de Bouddha : le Nirvana.
Les « Thankas », bannières sacrées qui ornent temples et couvents thibétains, sont de véritables textes religieux bouddhistes, traitant, dans le style décoratif, les thèmes lamaïques classiques.
Le thanka le plus célèbre : le Sipa Khorbo ou « cycle de l’existence » décrit les différentes transformations possibles avant le Nirvana du Bouddha. L’éventualité la plus heureuse est la réincarnation dans le royaume des Dieux, puis dans le royaume des humains, des titans, des animaux.
Le Sipa Korbo reconnaît deux états d’animaux : le monde des animaux libres au-dessus des eaux, le chien étant le plus noble de ces privilégiés, et le monde des animaux vivant sous les eaux, tenus en servitude.
A la lumière de ce texte reproduit dans tous les lieux religieux thibétains, notre ami, le terrier de Lhassa, apparaît, certes, comme un refuge de choix pour ces « namchés » errantes condamnées à une vie nouvelle dans le monde des animaux ; mais nous ne suivrons pas certaines revues canines fantaisistes qui ont voulu faire du terrier de Lhassa, le mausolée de personnages distingués du Thibet, le riche Thibétain désignant de son vivant le chien qui sera nourri de son cadavre.
Cette légende trouve son origine dans les deux modes de sépultures en vigueur au Thibet.
Le corps, libéré du « mental », est considéré comme négligeable : les gens aisés sont incinérés, quant aux autres, leur corps est placé en un lieu désert, fréquenté des animaux sauvages.
Il est possible que les chiens errants, dans les villages, participent au fossoyage, mais on ne voit absolument pas le petit terrier de Lhassa utilisé pour faire disparaître le corps d’un riche lama.
La mode et le snobisme en matière de chiens d’agrément ont besoin de races nouvelles rendues brusquement célèbres, soit par la position du personnage qui les lance, soit par l’originalité de leur beauté conventionnelle ou de leur histoire.
Le « lancement » du terrier de Lhassa a été ainsi assuré, au moins en partie, par le caractère sacré que certains amateurs lui ont constamment attribué.
Deux voyageurs de Bâle viennent de faire connaître qu’ayant été reçus, en mars 1961, chez le grand Lama d’un monastère thibétain situé près de la capitale du Népal, ils s’enquérirent sur la possibilité d’obtenir un des petits chiens qui entouraient le dignitaire. Ce dernier leur répondit qu’il lui était interdit de satisfaire leur demande car ces chiens étaient nés au monastère ; de ce fait, ils sont sacrés et ne doivent pas sortir de l’enceinte du lieu saint.
Nous nous sommes volontairement étendu sur les rapports pouvant exister, dans quelques cas, entre la religion thibétaine et le chien Lhassa-Apso ; mais nous voulons surtout présenter la vie de notre petit ami sous son aspect véritable, celle d’un aimable compagnon, vivant choyé dans les demeures des Thibétains aisés.
Chapitre trois
Le terrier de lhassa en Chine et aux Indes
Origine :
Les Chinois appellent indifféremment « chiens-lions » les chiens pékinois et thibétains. Cependant, les gens s’intéressant aux chiens savent fort bien distinguer le « Lhassa sheu tzeu koou » ou « chien lion de Lhassa » du « sheu tzeu hapaer » ou pékinois. Le docteur Water Young de Pékin publia, dans « the peiping chronicle », une série d’articles sur les chiens thibétains en Chine à l’occasion de la première exposition internationale de chiens à Pékin, le 7 juin 1934.
Selon lui, les « chiens lions » thibétains auraient été introduits en Chine durant la dynastie mandchoue comme cadeau des grands lamas aux empereurs chinois.
Les grands lamas encourageaient la tendance des conquérants mandchous à orienter le bouddhisme vers le type lamaïque et, en particulier, à cultiver le symbolisme du lion dont la représentation du lama de Manjuri, porté dans l’espace par un lion est l’expression.
Le culte du petit « chien lion » en Chine paraît avoir atteint son point culminant durant le règne de Tao Kouanf, c’est-à-dire entre 1821 et 1851.
Cette vogue a stimulé, dans l’entourage des empereurs, l’élevage des « chiens lions » thibétains, Miss Catherine Carl, qui vivait à la cour impériale, raconte qu’un des favoris de l’impératrice douairière était un chien à long poils qu’elle appelait « Thibétain ».
Le shih-tzu
Du croisement des chiens thibétains élevés en Chine avec les pékinois est né le shih-tzu ; il doit son nom au mot chinois « sheu tzeu » désignant le lion.
Le shih-tzu a conservé le poil long, laineux et abondant du chien thibétain, mais a pris au pékinois ses pattes courtes et surtout, sa face aplatie avec, cependant un chanfrein non ridé.
Sa robe est nettement plus garnie que celle du pékinois, surtout sur la face ; il porte barbe et moustaches fournies et, sur le crâne, une riche touffe de poils retombant sur les yeux donnant l’effet « chrysanthème » du terrier.
En dehors de la création du shih-tzu, il est probable que les Chinois ont utilisé les « chiens lions » du Thibet, pour donner sa longue et magnifique robe au pékinois moderne.
On retrouve à Pékin, et dans toute la Chine, les deux races de chiens thibétains à longs poils : le terrier du Thibet généralement blanc ou ivoire, et l’autre race comprenant le terrier de Lhassa ou apso. Ces deux races, nous dit le docteur Young, sont bien fixées, et les « marchés de chiens » de Loung Fou Szeu et de Houo Kono Szeu en offrent des spécimens blancs de grande taille et des terriers de Lhassa blancs et noirs.
De la Chine, les chiens thibétains ont gagné les Indes où l’on établit en 1901 le premier standard du Lhassa.
En 1931, le Kennel Club Indien distingua un type de la plus grande taille et définit ainsi le standard de la race « Terrier du Thibétain ».
Chapitre quatre
Les chiens lions thibétains en Europe
Depuis la fin du XVIIIème siècle jusqu’à il y a quelques années encore, le Thibet était un pays secret, fermé aux étrangers.
Certains téméraires s’étaient aventurés, en déployant force ruse, dans le pays considéré comme le toit du monde.
C’est ainsi qu’Alexandra David Néel nous décrit sa marche vers Lhassa sous le déguisement d’une pèlerine mendiante.
Un dogme religieux interdisait quatre commerce aux Thibétains : celui des armes, des êtres vivants (esclaves et animaux) de la viande et des boissons enivrantes. Si, pour une raison religieusement valable, un Thibétain ne pouvait conserver un animal, il devait lui trouver un nouveau maître susceptible de la traiter avec autant de bonté.
Il faut voir, dans ces différents facteurs, l’apparition tardive des petits chiens thibétains en Europe.
Peu d’étrangers avaient réussi à gagner le Thibet et la méfiance, l’hostilité que leur témoignaient les indigènes, interdisait à ces aventuriers courageux de ramener ces originaux chiens thibétains protégés par les dogmes lamaïques contre les tractations commerciales.
Deux moyens d’exportation étaient possible : le passage en fraude d’un couple de chiens ou, mieux, gagner la confiance d’un Thibétain qui accepterait, alors, de confier un chien thibétain à un nouveau maître offrant toutes les garanties de bonté.
C‘est ainsi, sous forme de cadeaux, que les premiers chiens thibétains arrivèrent en Europe ; il semble que ce soit à Mrs Bailley que nous en devions l’introduction.
Voici la traduction du récit de l’origine de son chenil, qu’elle fit dans le « Kennel Gazette » d’avril 1934.
« En 1920/21, le Colonel R.S. Kennedy était à Lhassa pour un an comme officier médical avec Si Charles Bell qui, à cette époque était attaché politique au Thibet. En reconnaissant pour le traitement de sa femme, le commandant en chef, Tsarong Shape, voulut offrir au Colonel Kennedy un cadeau de grande valeur. Le Colonel refusa mais accepta deux chiens.
Le mâle fut appelé « Sengtru » et la femelle « Apso ».
Il emmena ces deux chiens aux Indes mais, en 1922, il quitta le poste que lui avait confié le gouvernement et me fit cadeau des deux chiens.
Mon mari était à ce moment détaché politique au Thibet, ayant pris la succession de Sir Charles Bell en 1921.
Nous visitions le Thibet tous les ans, emmenant nos deux chiens et nous en cherchions d’autres ayant les mêmes caractéristiques.
En 1924, mon mari passa un mois à Lhassa et voyant fréquemment le Dalaï Lama, chercha par l’intermédiaire de Sa Sainteté et de hauts fonctionnaires, d’autres chiens du même type.
Il trouva ainsi une chienne nommée « Demon », appartenant à un jeune officier Thibétain qui refusa de s’en séparer mais nous la confia pour la reproduction ; après avoir eu une portée de Sengtru, elle fut renvoyée au Thibet et perdue en route. »
Ce couple de chiens thibétains appartenait à la race que Mrs Bailley nomme « Apso » (venant de rapso qui veut dire : comme une chèvre, selon Mrs Bailley) ; la longueur de la fourrure dorée de ces deux chiens les faisait ressembler aux petites chèvres thibétaines.
Ainsi, les premiers « terriers de Lhassa » introduits en Europe aux alentours de 1922 étaient de la variété Apso ; ce mot apparut pour la première fois en Europe, dans le Daily Mail du 15 août 1929.
Quelques années plus tard, Mrs Greig, médecin aux Indes, ramenait en Angleterre des chiens lions de plus grande taille, cadeaux d’un Thibétain en reconnaissance de soins donnés.
Ces chiens lions appartenaient à la race de plus grand format appelée en Europe « Terrier du Thibet » et dont Madame Lisa Packinger retrace les origines romanesques dans un article paru le 8 mai 1953 dans la revue « Schveizer Hund-Spot » de Berne.
Ces chiens, connus au Thibet depuis 2000 ans, viendraient de la vallée nommée maintenant « vallée perdue », au moment du grand tremblement de terre qui bouleversa cette vallée, il y a 600 ans environ. Des lamas emportèrent quelques uns de ces chiens. Depuis leur descendance serait élevée dans des monastères où on les considère comme des « messagers de paix et de bonheur ». L’histoire est jolie sinon authentique.
L’Allemagne et l’Autriche connurent plus tard les chiens lions thibétains ; un standard autrichien est l’un des derniers en date.
En 1939, le docteur Schaffer, chef de mission à Lhassa, ramena trois couples de chiens lions et des documents qui confirmaient la fixité des deux races au Thibet : celle plus petite du terrier de Lhassa avec sa variété miel : l’Apso, et la race du terrier du Thibet qui mesure 10 cm de plus environ au garrot.
En France, on put voir à l’exposition de la Société Française des amateurs de chiens d’agrément, en décembre 1921, un premier couple de chiens baptisés « griffons thibétains », achetés à Pékin.
D’après le revue « Vie à la Campagne », ces chiens avaient la face plate avec un museau extrêmement court, ridé, et une tête toute en mèches folles qui leur fit donner le nom de « chiens chrysanthèmes ».
Cette description ne correspond cependant pas au standard du terrier du Thibet ou au terrier de Lhassa.
Leur origine pékinoise et leur museau extrêmement court incitent à penser que ces chiens étaient très certainement des Néel Tzu : création chinoise résultant, probablement, du croisement Lhassa-Pékinois.
Plus tard apparurent en exposition de véritables chiens thibétains et HEUILLET put décrire, en 1934, dans son livre « Tous les Chiens » : le « Lhassa » ou « Chien Mandchou » et sa variété « Apso ».
Aujourd’hui, on emploie indifféremment les dénominations « Terrier de Lhassa et Apso » pour désigner le même chien.
Chapitre cinq
Le terrier de Lhassa Apso – description
En 1934, au Congrès cynologique mondial de Monaco, s’élevant contre l’imprécision des standards, le professeur Solaro (Italie), Monsieur Huge (Belgique) et le docteur vétérinaire Hérout (France) faisaient admettre, concernant le standard type, le vœu suivant : « A l’effet de permettre aux organismes réunis à Monaco, dans le but de donner des directives aux éleveurs, de fixer les limites entre lesquelles la conformation d’un chien peut varier, de réduire au minimum l’amplitude des oscillations d’une race, nous demandons que les mensurations d’ordre essentiel (d’un point osseux à un autre point osseux) du prototype de chaque race, soit indiqué dans le standard. Estimant que les mensurations sont le complément indispensable d’un standard nous émettons le vœu que tous les champions soient mesurés.
A la lumière des indications fournies par le docteur vétérinaire Hérout, dans le « Précis d’extérieur du chien », nous nous sommes astreints à une étude détaillée des différentes régions, et en particulier de la tête, dont les formes se répercutent sur la morphologie générale du sujet et, estimait le professeur Baron, sont les moins sensibles aux variations.
Caractères généraux de la race
Dans la classification scientifique du professeur Dechambre, le terrier de Lhassa serait un sub-concave, sub-bréviligne, ellipométrique.
Nous avons respecté ici, autant que possible, le standard de la race Lhassa-apso, tel qu’il a été établi par les éleveurs Anglais. Nous y avons apporté, cependant, des modifications, qui nous ont parues indispensables.
L’aspect général du terrier de Lhassa est celui d’un chien de petite taille, nettement plus long que haut, dont l’originalité réside dans une robe aux poils très longs et très denses, mais ni bouclés ni frisés. Le fouet est porté relevé sur le dos en arc de cercle. Les poils du corps, séparés par une raie, allant du stop jusqu’à la base de la queue, tombent très bas de chaque côté sans toucher le sol.
La tête est ornée d’une riche garniture de longs poils, dite en forme de chrysanthème, cachant les yeux et la face.
Le corps est allongé et les membres assez courts ; les membres antérieurs sont un peu plus courts que les postérieurs.
- le mâle mesure entre 22 et 28 cm au garrot et la femme entre 22 et 25 cm
- le poids varie de 4 à 7 kg
- couleur : doré, sable, grisaille foncé, ardoise, noir
La couleur uniforme est recherchée en France. Les éleveurs Anglais admettent les robes tachetées, à fond blanc avec des taches marron ou noire.
- d’un tempérament gai et actif, c’est un chien de compagne agréable
Caractères descriptifs détaillés :
Pour préciser ces caractères, nous avons examiné les dix sujets ayant obtenu les plus hauts prix aux expositions françaises (élevage Annapurna).
MORPHOLOGIE
I - TÊTE
A - Aspect général
Le volume de la tête est moyen par rapport au corps. La longueur, prise de la crête occipitale externe à l’extrémité antérieure du nez, est de 10.5 cm en moyenne, pour une longueur totale du corps, prise de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse, de 31 cm.
Un juste équilibre entre la musculature et l’ossature donne une impression de distinction.
La largeur de la tête, au niveau des arcades zygomatiques, est de 7 cm environ, alors que la longueur totale de la région crânio-frontale prise sur les mêmes sujets, de la crête occipitale à la ligne réunissant les angles internes des paupières, donne un chiffre moyen de 6.5 cm. Cette légère prédominance de la première dimension permet, selon le docteur vétérinaire Hérout, de classer le terrier de Lhassa au point de vue craniométrique dans les brachycéphales, mais un brachycéphale limite, se rapprochant du type moyen mésaticéphale.
Les axes longitudinaux du crâne dont les directions respectives sont déterminées par deux lignes, l’une donnée par le profil supérieur du chanfrein, l’autre prenant naissance au niveau de l’arcade sourcilière pour aboutir à la crête occipitale, sont très légèrement convergentes, dessinant un profil faisant du terrier de Lhassa un sub-concaviligne dans la classification du professeur Dechambre.
B – Etude détaillée de la tête
a) face supérieure : région cranio-frontale :
Le crâne est légèrement plus large que long, son profil supérieur est légèrement bombé.
La région crano-frontale est la région la plus longue de la partie supérieure de la tête. Pour une longueur totale de la tête de 10.5 cm, la région crânienne mesure 6.5cm et la région faciale 4 cm. Selon le docteur vétérinaire Hérout, cette prédominance nette de la portion crânienne sur la portion faciale, dans le sens longitudinal, suivant la proportion de 3 à 2 environ, et l’indice crânien légèrement inférieur à 1, permettent, par la seule donnée du crâne, de classer morphologiquement le terrier de Lhassa dans les sub-brévilignes. Les proportions corporelles affirmeront cette classification.
- sillon frontale : légèrement marqué
- stop ou cassure fronto-nasale : moyennement accusé
L’angle formé par la région crânio-frontale et le chanfrein est de 130° en moyenne. L’angle du stop chez les médiolignes tend vers 145° alors qu’il se rapproche de 90° les ultra-brévilignes ; l’angle fronto-nasale du Lhassa (avec 130° environ) est donc bien d’un sub-bréviligne.
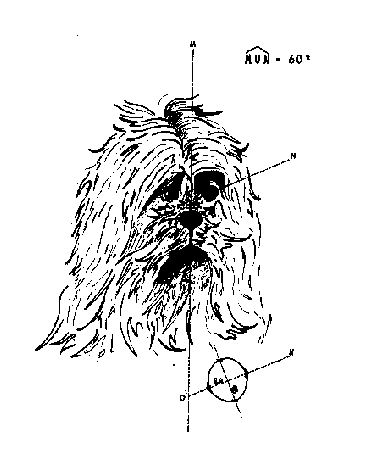
- Museau – chanfrein : la partie supérieure du museau est rectiligne ; sa longueur prise de la pointe du nez à la ligne joignant les angles internes des yeux est de 4 cm. De forme trapézoïdale, le museau a une largeur moyenne de 4 cm à sa naissance alors que sa partie terminale mesure 3 cm.
- Palais noir, très fortement pigmenté.
b) face inférieure : région sous maxillaire
De forme trapézoïdale, le maxillaire inférieur peut rencontrer l’extrémité du maxillaire supérieur de façon que les incisives s’affrontent exactement ; mais il peut aussi être un peu plus long et présenter ainsi un léger prognathisme inférieur. Sur les sujets examinés, cette position undershot a toujours été inférieure à 0.5 cm.
c) face latérale :
La région parotidienne est entièrement recouverte par les oreilles :
OREILLES
Celles- ci, de grandes dimensions et garnies de poils très longs et denses, sont portées tombantes, plaquées le long de la région parotidienne ; leur bord antérieur doit être oblique vers l’arrière.
Leur attache, basse, suit une ligne oblique de haut en bas et d’avant en arrière. Le point d’attache antéro-supérieur de l’oreille est placé à 1,3 cm au-dessus d’une ligne tangente à la face supérieure du nez en passant par l’angle externe de l’œil : le point d’attache inféro-postérieur se trouve à 2 cm en dessous de cette même ligne.
Le bord intérieur dessine une ligne droite, oblique d’avant en arrière et de haut en bas, le bord postérieur est fortement convexe vers l’arrière. L’extrémité est légèrement pointue.
La pointe de l’oreille du terrier de Lhassa dépasse de 3 à 4 cm la limite inférieure de la gorge.
YEUX
Les arcades sourcilières sont légèrement marquées.
Les yeux, très vifs, noirs ou du moins de teinte la plus foncée possible, sont de forme et de dimensions normales (ni trop grands et proéminents, ni trop petits et enfoncés).
PAUPIÈRES
L’ouverture palpébrale, par sa forme et sa direction, est celle d’un sub-concave.
Le diamètre reliant l’angle nasal à l’angle temporal des paupières est de 20 mm environ, alors que le diamètre vertical mesure 18 mm en moyenne. L’angle nommé axio-palpébral par le docteur vétérinaire Hérout, formé par la ligne réunissant les deux angles de l’ouverture palpébrale et le plan médian de la tête passant par le milieu des naseaux, est voisin de 60° (voir dessin, angle M.O.N.).
Les bords des paupières sont minces, noir foncé et garnies de cils très longs mesurant 3 à 4 cm.
JOUES
Légèrement convexes, elles sont recouvertes en partie par les oreilles.
d) extrémité antérieure de la tête
LÈVRES
Une perpendiculaire au bord inférieur de la lèvre supérieure élevée du point le plus postérieur de la commissure des lèvres, passe par le milieu de l’œil.
Les bords labiaux sont noirs, très fortement pigmentés, les lèvres sont garnies de moustaches fournies atteignant 10 cm de longueur.
NEZ
La truffe est proéminente, large par rapport à l’extrémité du museau, les narines sont très ouvertes et la gouttière de l’extrémité antérieure de la cloison nasale est bien marquée, mais ne doit pas diviser le nez en deux.
De profil, la face supérieure du nez apparaît légèrement oblique vers le haut, relevant ainsi la portion terminale de la ligne supérieure du chanfrein. La truffe doit être fortement pigmentée de noir.
e) extrémité postérieure de la tête
CRÈTE OCCIPITALE
Très légèrement marquée.
NUQUE
Presque droite.
Conclusion de l’étude de la tête :
L’appréciation d’un sujet, du point de vue morphologique, doit être fondée pour une très grande part sur les données céphaliques et les caractéristiques des extrémités.
Avant d’étudier la plus ou moins bonne conformation du corps et des membres, il faut tout d’abord bien se convaincre, par l’étude de la tête et de la queue, que le chien présente bien les caractéristiques de sa race.
Il ne suffit pas qu’un chien paraisse bien construit s’il n’est pas racé.
Les mensurations céphaliques sont prédominantes dans l’établissement des proportions et des indices qui permettent de classer morphologiquement un type racial.
Il ressort de l’étude détaillée de la tête du terrier de Lhassa, que l’on peut, en fonction de ses proportions, le faire entrer dans les catégories des sub-brévilignes sub-concaves.
C’est un sub-bréviligne pour quatre raisons :
1) Il y a prédominance de la région fronto-cranienne sur la région faciale dans le rapport.
Longueur du crâne (6.5 cm) 3
_____________________ ___ (environ)
Longueur de la face (4 cm) 2
2) La largeur du crâne est légèrement supérieure à sa longueur.
Longueur du crâne (6.5cm)
_____________________ < 1
Largeur du crâne (7 cm)
3) L’angle du stop est de 130° intermédiaire entre les médiolignes (oscillant aux environs de 145°) et les ultra-brévilignes (approchant de 90°).
4) Le maxillaire a tendance à présenter un léger prognathisme inférieur.
C’est un sub-concave car :
A) Les axes longitudinaux définis dans l’étude de l’aspect général de la tête sont légèrement convergents.
B) L’angle axio-palpébral de 60° est intermédiaire entre l’angle aigu des rectilignes et l’angle proche de 90° des ultra-concaves.
C) Le rapport des deux axes de l’ouverture palpébrale tend vers l’unité.
(voir dessin)
D) l’angle axio-facio-latéral assuré par les deux lignes, l’une partant du point latéral externe le plus saillant du crâne et arrivant au niveau de la sortie de la canine, l’autre étant l’axe de la tête, est de 40°.
Ces différents angles céphaliques ont été étudiés sur des radios de tête de plusieurs sujets ; l’abondance de poils ne permettant pas l’examen direct de l’animal.
II – ENCOLURE ET TRONC
L’encolure est assez courte et légèrement arquée.
La longueur scapulo-ischiale (de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse) est plus grande que la hauteur au garrot.
POITRINE
Large et profonde. Les lignes de dessus et dessous sont parallèles dans toute la région de la poitrine.
Largeur de poitrine : 9.5 cm
Hauteur de poitrine : 11 cm
Ces mensurations concernent des sujets ayant une taille au garrot de 22 cm. En général, la hauteur de poitrine est égale au vide sous-sternal.
Rein puissant, hanches bien développées, cuisses musclées.
LIGNE DE DESSUS
Ligne de dessus rectiligne, mais légèrement plongeante vers l’avant, la hauteur au rein étant un peu plus grande que la hauteur au garrot.
LIGNE DE DESSOUS
Sensiblement horizontale dans sa partie antérieure, elle devient légèrement oblique en arrière et en haut dans sa portion postérieure.
FOUET
Le fouet est long ; étant étendu, il dépasse la pointe du jarret de 2 cm. Attaché haut, il continue harmonieusement de la ligne de la croupe et, 2 cm après son attache, il se recourbe sur le dos, se déviant sur l’un ou l’autre des côtés de celui-ci, mais sans réaliser un véritable enroulement.
On signale que beaucoup de terriers de Lhassa , au Thibet, ont, à l’extrémité du fouet, une sorte de « nœud », formé vraisemblablement par la soudure des deux dernières vertèbres coccygiennes ; cette particularité n’est pas constante et son absence ne constitue pas un défaut.
Les poils du fouet, très longs, ondulés, forment un riche panache.
III – MEMBRES
A) Membre antérieur
APLOMB
L’aplomb général du membre antérieur doit former, de face et de profil, un angle droit avec le sol.
ÉPAULE
L’épaule est assez courte ; la longueur prise de la pointe de l’épaule à l’angle supérieur de l’omoplate est de 9 cm environ. Elle forme avec l’horizontale un angle de 65°, et l’ouverture de l’angle scapulo-huméral est de 115°. On peut dire que l’épaule est plutôt droite : l’obliquité peu accusée donne au Lhassa cette marche dite « steppante », caractéristique des races de terriers.
BRAS
Légèrement plus long que l’épaule, il fait avec l’horizontale un angle de 50° environ ; il est dirigé parallèlement au plan médian du corps.
AVANT BRAS
Il est court et droit ; sa longueur prise de la pointe du coude au genou est de 8 cm environ.
RÉGION CARPIENNE
Droite.
PIEDS
De forme arrondie, reposent sur une sole très noire. Les ongles doivent être noirs ou gris foncé.
Les espaces interdigités sont garnis de poils très longs.
La longueur et la densité des poils qui couvrent le membre antérieur jusqu’à son extrémité donnent une impression de lourdeur.
B) Membre postérieur
APLOMB
Le membre postérieur forme, vu de l’arrière, un angle droit avec le sol, mais, vu de profil il est légèrement oblique d’avant en arrière et de haut en bas.
FESSE
Légèrement convexe.
JARRET
L’angle tibio-tarsien, assez ouvert, est de 150° environ.
Les membres postérieurs sont plus hauts que les membres antérieurs. Chez un sujet mesurant 24 cm au garrot, la hauteur du rein est de 25.5 cm.
C) Pelage
La beauté du terrier de Lhassa réside en une fourrure opulente, très dense et longue.
Texture du poil :
POIL DE COUVERTURE
Le poil de couverture est fin, long, généralement doux au toucher ; quelques fois un peu plus dur sur le dessus du dos.
Ce poil de couverture est légèrement ondulé, il n’est jamais bouclé ni frisé.
Les poils les plus longs, dans la région du dos, peuvent atteindre 25 cm. La longueur moyenne est de 15 cm.
SOUS-POIL
L’ensemble du corps est couvert d’un sous-poil dense, court et fin, mais laineux au toucher, avec tendance nette au feutrage.
Répartition naturelle du poil :
Une disposition particulière des poils fait l’originalité essentielle de la tête du Lhassa.
De longs poils très denses semblent jaillir du sommet du crâne pour retomber de chaque côté, en suivant la direction des oreilles, séparés et disciplinés par une raie très nette. De plus, une frange de sourcils, exceptionnellement longs, recouvre le chanfrein et parfois même la truffe, tamisant la vivacité du regard. Ces deux implantations différentes des poils de la tête donnent de cette dernière, vue de dessus, un aspect particulier qui avait valu, aux premiers terriers de Lhassa exposés à Paris, le nom de « chiens chrysanthèmes ».
Les poils recouvrent entièrement le museau. A ce niveau, ils sont également séparés par une raie suivant la ligne supérieure du chanfrein, et renforcés par des moustaches très fournies que prolonge une petite barbe.
La répartition du pelage est identique sur le corps, avec une raie prolongeant celle de la tête jusqu’à la naissance de la queue et séparant ainsi l’opulente fourrure, qui se répand de chaque côté de l’encolure et du tronc.
Les poils de la queue, nous l’avons vu, forment un très riche panache.
Les membres sont couverts, jusqu’aux espaces interdigités, de poils formant de petites bottes de fourrure.
COULEUR
Elle est le plus souvent crème ou sable, avec des marques noires à l’extrémité des oreilles, de la barbe et de la queue.
La robe peut être également noire, avec des taches blanches ou miel ; gris foncé, ardoise, fumée ou saumon.
D) Allures – Tempérament
ALLURES
Les allures du terrier de Lhassa sont marquées d’un trait dominant : la vivacité. Il est loin de cette lenteur, qui se veut majestueuse, mais n’est souvent qu’impuissance, propre à certaines races de « chiens de salon », prisonniers d’une fourrure dûment cultivée, et dont les pattes, invisibles sous le manteau de poils, s’entravent dans les mèches. Si le Lhassa doit une grande part de sa beauté à l’opulence de sa robe, il n’en subit nullement l’esclavage. Constamment en mouvement, à la moindre sollicitation, il accourt de sa marche sautillante caractéristique, la tête dressée en un port fier, distingué, voire arrogant, la touffe de poils de la queue déployée en un gracieux panache.
TEMPÉRAMENT
Certaines caractéristiques physiologiques et psychologiques sont l’attribut d’une race tout comme la morphologie ; leur combinaison harmonieuse détermine le tempérament et le caractère du sujet.
Le tempérament est un état physiologique, influencé par la prédominance de certains éléments qui déterminent un ensemble de qualités et d’aptitudes spéciales. On est en droit de se demander si le chien de Lhassa possède cet « ensemble de qualités et d’aptitudes spéciales » du tempérament terrier.
Bien qu’il soit, en France, chien d’agrément, le chien Apso prend plaisir à fouiller le sol, à poursuivre les lapins. On peut donc dire qu’il mérite la qualification de terrier. Il est à considérer, d’autre part, que l’on classe, dans le groupe des terriers, certains chiens ne possédant pas un tempérament assez marqué pour que l’appellation « terrier » conserve toujours sa pleine valeur première. Les éleveurs anglais tendent actuellement à supprimer le terme terrier pour le Lhassa-apso, pour éviter la confusion avec le terrier du Thibet.
CARACTÈRE
Le terrier de Lhassa est très actif, alerte et enjoué. Intelligent, il possède une mémoire extraordinaire et reconnaît des lieux ou des personnes qu’il n’a pas vus depuis des années. Il a besoin de vivre en compagnie étroite avec les hommes et, en particulier, adore jouer avec les enfants. Il fait preuve d’une grande fidélité, mais, triste en l’absence de son maître, n’accepte absolument pas d’être relégué au chenil.
C’est un gardien instinctif, avide de se rendre utile ; il se couche sans commandement près de l’objet que l’on a posé à terre, et personne ne peut en approcher, même pas le chat de la maison, avec lequel il fait cependant bon ménage.
Il est très sensible et même susceptible ; selon le docteur Schaffer, chef de mission allemande au Thibet : « Il faut savoir le prendre, c’est un oriental, il n’est pas esclave comme le chien de l’occident. »
E) Défectuosités à éviter
Certaines défectuosités peuvent être considérées comme absolues. Relatives à la conformation, elles se situent surtout au niveau des membres où l’on peut trouver des vices graves d’aplomb.
On peut signaler comme défectuosités relatives celles qui éloignent le sujet des caractéristiques considérées comme étant celles de sa race. Citons notamment :
- Crâne globuleux, allant de pair avec un écartement excessif des yeux.
- Stop trop accusé.
- Chanfrein trop court. Sa longueur ne doit pas être inférieure à 3,5 cm.
- Prognathisme inférieur, s’il excède 5 mm.
- Prognathisme supérieur (disqualificatif dans tous les cas).
Certaines défectuosités sont considérées comme plus légères : oreilles trop courtes, poil un peu bouclé, coloris différent de ceux qu’exige la mode. Les couleurs en vogue actuellement sont claires. La recherche de l’éclaircissement excessif du pelage peut entraîner une dépigmentation des orifices naturels avec apparition de taches de ladre sur la truffe et les lèvres.
Ces troubles de pigmentation sont d’ordinaire sévèrement pénalisés.
Chapitre six
Distinction entre le terrier de Lhassa et quelques races voisines
Il existe plusieurs races avec lesquelles on a confondu ou on peut confondre le terrier de Lhassa, d’abord parce que quelques unes d’entre elles se trouvent dans la même région ; ensuite parce que les auteurs qui, les premiers, les ont décrites n’ont pas saisi les différences qui les séparaient ; enfin parce qu’il est vraisemblable que des croisements ont eu lieu entre diverses races, amenuisant les caractères propres à chaque entité ethnique.
Aujourd’hui que l’on connaît mieux les traits originaux des représentants de l’espèce canine, il semble que l’on puisse distinguer les races suivantes :
1- L’Apso ou terrier de Lhassa ci-dessus décrit
2- Le Shih-Tzu ou chien sino-thibétain
3- Le terrier du Thibet
4- L’épagneul du Thibet
5- Le chien Maltais
Nous ne nous proposons pas de donner une description détaillée de chacune des races. Toutefois, nous signalerons les traits essentiels qui les distinguent du terrier de Lhassa.
LE SHIH-TZU
Il est d’un modèle un peu plus lourd que le précédent, son poids atteignant 4 à 8 kg, parfois 9. S différence morphologique essentielle avec l’Apso réside dans le raccourcissement de sa face. Sur un sujet de format moyen, la longueur du chanfrein est en effet de 2,5 cm au lieu de 3.5cm chez l’Apso.
Ses incisives sont plus larges que celles de l’Apso.
Il est vraisemblable que ce chien dérive de croisement entre chiens thibétains élevés en Chine et chiens pékinois, à face extrêmement réduite. Le nom de Shih-tzu dériverait du mot chinois « sheu tzeu », désignant le lion.
Le shih-tzu a pris au pékinois la face aplatie bien que le chanfrein ne soit pas recouvert de rides cutanées. Sa robe est nettement plus garnie que celle du pékinois, notamment sur la face, recouverte, non de poils courts comme chez ce dernier mais de poils longs retombant sur les yeux pour donner « l’effet chrysanthème », et formant barbe et moustaches fournies.
Ce chien ne serait pas un terrier.
LE TERRIER DU THIBET
Le chien désigné aujourd’hui sous le nom de terrier du Thibet apparaît comme une forme amplifiée du terrier de Lhassa ; les mâles doivent, en effet avoir une taille de 35 à 40 cm au garrot, les femelles étant légèrement plus petites.
La face est bien développée, le stop marqué, mais sans exagération. La coaptation des deux arcades incisives n’est pas toujours parfaite ; on tolère un léger prognathisme inférieur.
Ce chien n’est pas sans ressembler, dit-on, à un type réduit du vieux chien de berger anglais (bobtail ou old english sheep dog) ; comme ce dernier, il possède une riche fourrure laineuse couvrant la tête garnie de longs poils retombant devant les yeux ; la mâchoire inférieure porte une petite touffe de barbe, mais cependant non très développée. Par contre, à la différence du bobtail, il a une queue de longueur moyenne, très fournie en poils, formant un gai panache se déroulant sur le dos.
L’EPAGNEUL THIBETAIN
Encore dit « spaniel thibétain », il rappelle, par son allure générale, l’épagneul français nain, c’est-à-dire le Papillon, dans sa variété à oreilles tombantes. C’est un chien de petite taille quoique un peu plus corpulent que le Papillon ; les mêles mesurent jusqu’à 27 cm, les femelles jusqu’à 24 cm. Les mâles pèsent de 5 à 8 kg, les femelles 4.5 à 5.5 kg.
Le crâne est globuleux, la face plutôt courte, Aussi les incisives inférieures doivent être de préférence légèrement en avant des supérieures, bien que non visibles quand la bouche est fermée. L’animal porte une belle fourrure à poils droits mais touffus sur le cou et les épaules ; les membres sont couverts de longues franges à leur partie postérieure ; la queue, plantée haut, se développe en un riche panache et est portée en crête et recourbée sur le dos. Mais ce qui le distingue très nettement des races précédentes et notamment de l’Apso, c’est que le poil est court sur le dessus, sur les côtés et même à la partie inférieure de la tête. Cette particularité donne à l’épagneul thibétain une physionomie très différente de celle de l’Apso.
Son pelage est très varié, il peut être même bicolore ou tricolore.
Les standards de ces trois races sont maintenant homologués au kennel club de Londres.
LE CHIEN MALTAIS
Corps :
De taille sensiblement égale, il est moins long que le « Lhassa » ; bien qu’étant d’un poids inférieur, il paraît plus trapu. Il y a égalité de longueur entre les membres antérieurs et postérieurs. La queue est plus enroulée sur le dos que celle du Lhassa.
Tête :
Le Maltais est du même type céphalique que le Lhassa. Des mesures, faites sur plusieurs sujets des deux races, donnent dans les deux cas in rapport crânio-facial proche des 3/2, et des angles axio-palpébraux voisin de 60°.
Seule la disposition des poils crâniens varie, avec l’absence de « l’effet chrysanthème » chez le Maltais.
Robe :
La différence est ici très nette ; le maltais n’a pas de sous-poil de laine.
Le poil soyeux, et non laineux comme chez le Lhassa, est plus long ; il atteint couramment 30 cm.
Enfin la robe est toujours d’un blanc uniforme.
Chapitre VII
Hygiène et entretien du « terrier de Lhassa »
L’opulence de la robe du « terrier de Lhassa » exige des soins attentifs et continus.
TOILETTE D’ENTRETIEN
Maintenir la fourrure en bon état, tout en cherchant à lui donner le maximum de force et d’épaisseur, est un problème délicat. Baigner trop souvent augmente les risques de dermatoses ; ne pas brosser feutre le poil ; trop brosser le casse.
Voici quelle nous semble la façon la plus rationnelle de procéder : périodiquement, toutes les trois semaines en été, tous les deux mois durant la saison froide, donner un bain et laver avec n shampoing ou un savon acide pour conserve l’acidité cutanée. Il faut sécher immédiatement avec des serviettes chaudes ou au séchoir. Quotidiennement, brosser soigneusement les poils, peigner une fois par semaine. La toilette se fait en deux temps. Après avoir saupoudré la robe avec du talc, il faut défeutrer le sous-poil et démêler isolément chaque mèche de poil avec une brosse dure, en commençant par la base du poil. Le deuxième temps ou finissage, se fera avec une brosse plus douce ; il doit être l’objet de soins particuliers, dans la toilette précédant une exposition.
TOILETTE D’EXPOSITION
Un bain, donné quatre ou cinq jours avant, gonflera la fourrure. Après le démêlage, brosser soigneusement en respectant la raie de la ligne du dessus.
Sur la tête, après avoir fait la raie, ramener les poils sur les côtés et en arrière ; ils retombent d’eux même en « chrysanthème » sur les yeux. Brosser soigneusement la barbe. Il faut ensuite laver les yeux à l’eau boriquée et dégager les longs cils qui peuvent, parfois, irriter le globe de l’œil et entraîner le larmoiement.
Cette toilette d’exposition doit permettre de masquer honnêtement les petits défauts éventuels, tout en faisant ressortir les caractéristiques de la robe qui font l’élégance du lhassa : le panache terminal de la queue, la disposition rayonnante des poils sur le sommet du crâne, l’élégance de la chute des poils sur la ligne dorsolombaire.
ALIMENTATION
Au point de vue alimentaire, il convient de signaler une curieuse particularité physiologique presque constante, d’après les éleveurs.
Lorsque les jeunes chiens, âgés de quatre semaines environ, commencent à manger, la mère régurgite les aliments prédigérés qu’elle met à la disposition de sa portée.
Les éleveurs recommandent de nourrir copieusement la chienne pendant cette période de l’élevage et d’avoir soin de l’isoler de ses chiots durant une heure, après son repas, afin d’éviter une régurgitation trop hâtive.
CONCLUSION
« Parce qu’il est le plus dévoué des compagnons, parce qu’il est le plus désintéressé des amis, affectueux sans obséquiosité, plain d’aménité, le chien subit l’influence des caprices de l’homme. Mais c’est aussi parce qu’il flatte son amour-propre, parce qu’il est son agrément, qu’il est soumis à l’action de la mode » (D.V. E. Fabre – la mode et le chien – thèse de doctorat, Toulouse, 1936).
Que de races canines ont connu la faveur populaire à une époque, pour être ensuite oubliées !
P. Mégnin l’a dit : « Tous les chiens sont des chiens d’agrément » ; et l’agrément d’un chien, c’est l’originalité et la nouveauté. Aussi il n’est pas de race, soit-elle de garde, de chasse ou d’autre utilité, qui ne subisse la tyrannie de la mode.
Les races de compagnie sont, plus que toutes, sensibles aux fluctuations de l’engouement pour le chien. Successivement, les terriers anglais, le pékinois, le caniche, le teckel ont été les grands favoris mis en lumière et révélés par la mode.
Le terrier de Lhassa-apso est, en ce moment, un des chiens d’agrément le plus en vogue.
Dès son apparition en Europe, il suscita une grande curiosité, tout comme le pékinois, mais si l’originalité morphologique de ce dernier avait assuré son lancement, il semble que ce soit à ses origines que le terrier de Lhassa doive sa faveur actuelle.
On l’a présenté comme un chien sacré, réincarnation des lointains lamas, et le mystère des rites orientaux autorisait, en la matière, toutes les légendes.
Un personnage célèbre a patronné son apparition, le sherpa Tensing ; il élève de magnifiques sujets qui, dit-il, possèdent un sens très sûr de la montagne, et l’accompagnent dans ses ascensions.
En France, le Lhassa-apso est, par excellence, « le chien de la robe », pour les élégantes, dans les manifestations de haute couture.
Ce petit chien, tout en poils, a été très rapidement connu et adopté par l’ensemble du monde canin.